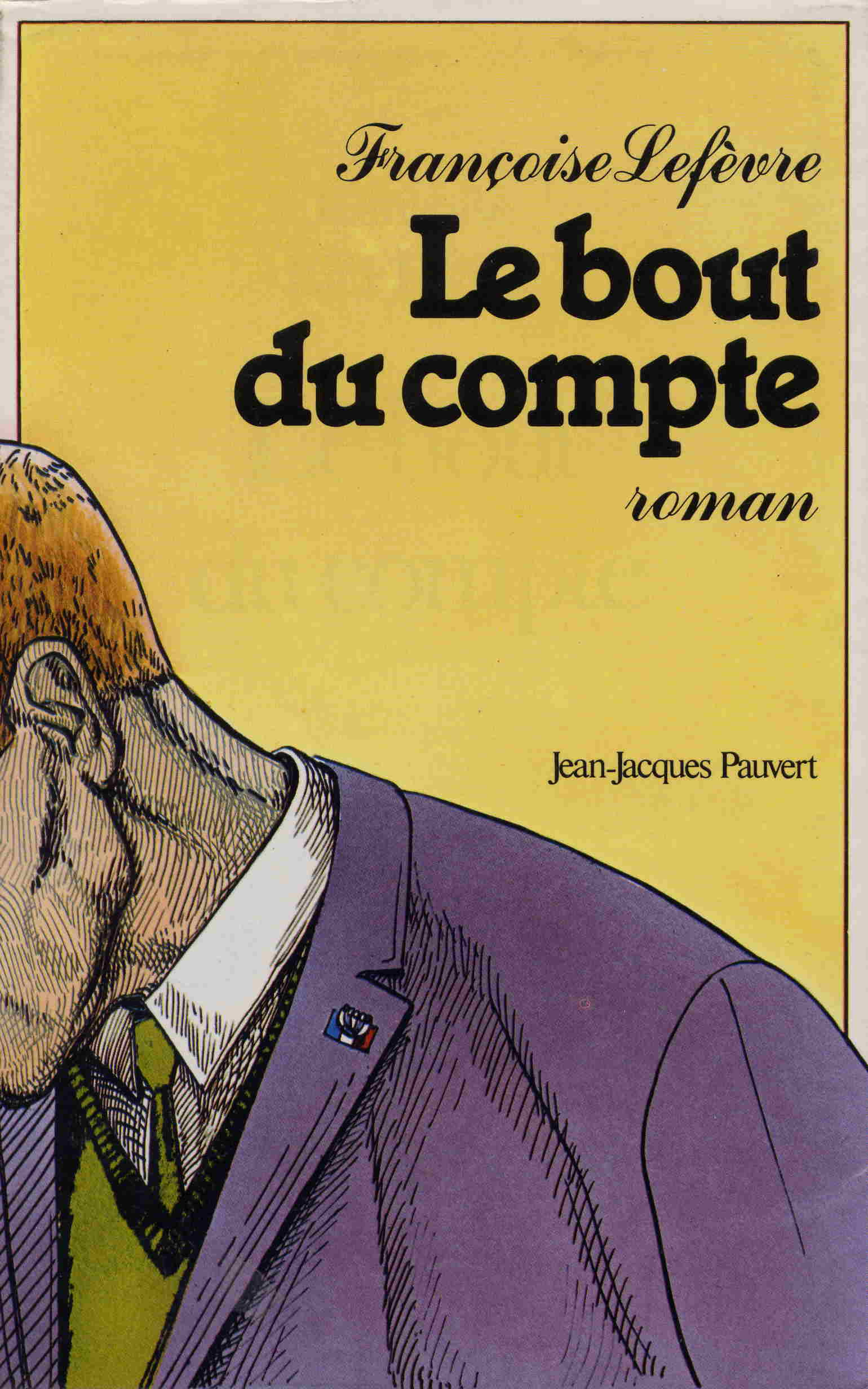 Le bout du compte,
Le bout du compte,Françoise Lefèvre, Jean-Jacques Pauvert Editeur, 1977
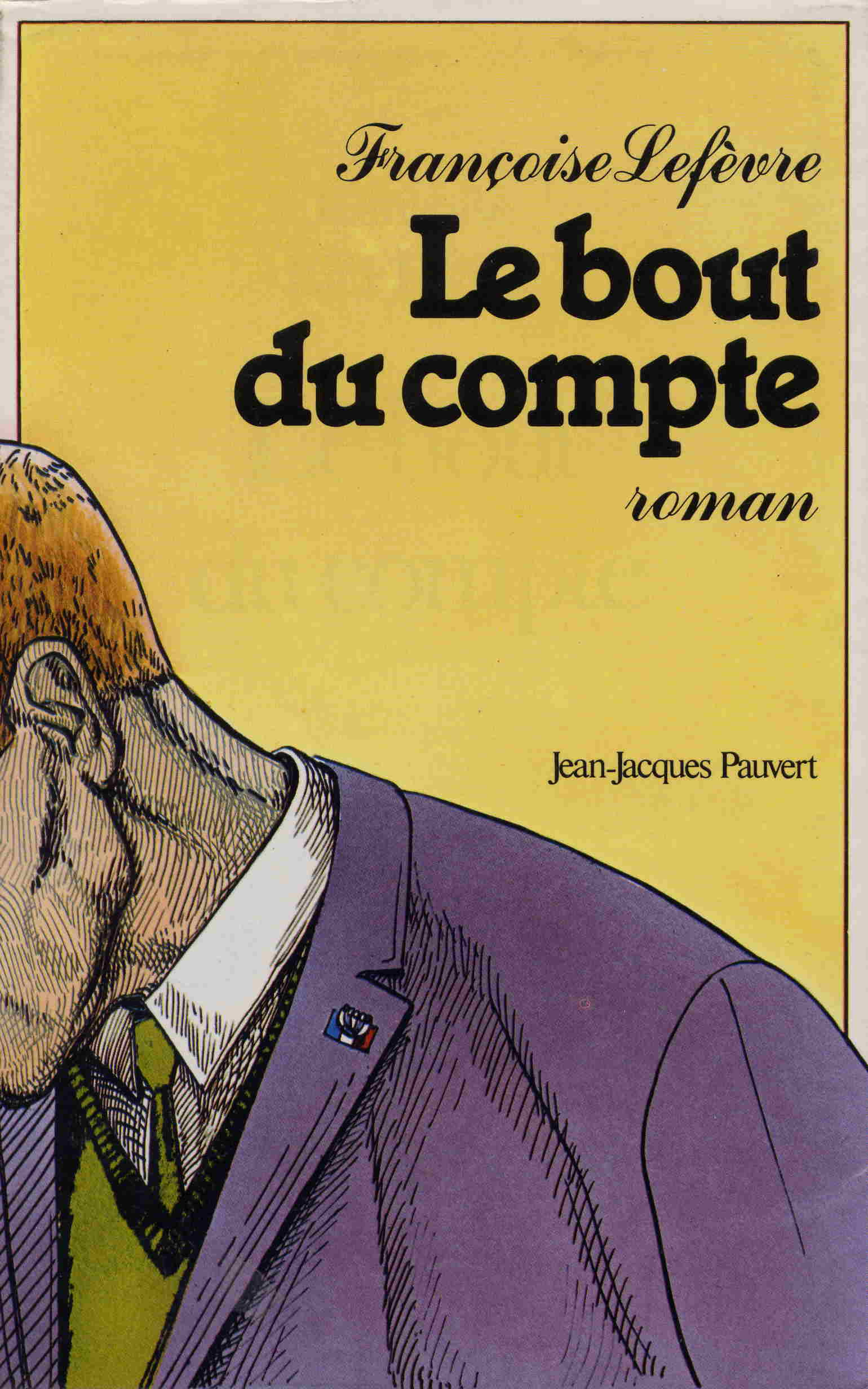 Le bout du compte,
Le bout du compte,
Françoise Lefèvre, Jean-Jacques Pauvert Editeur, 1977
Aujourd’hui quand les rues sont froides et que je ne sais où aller, je monte
six étages dans un vieil immeuble parisien. Je frappe à une porte. Là, je
sais que je serai accueillie. C’est un intérieur modeste où chaque chose a
trouvé sa place. Il fait bon chez eux. Si je le désirais je pourrais
m’endormir sur le divan. Quand j’arrive et que c’est l’hiver, ils se
penchent pour ouvrir la porte du poêle et activer le feu. On sent qu’ici,
chaque chose a son prix. On devine ce qu’a coûté le reps du divan,
maintenant un peu usé, sur lequel j’aime passer la main. On sourit à la
cretonne modeste des doubles rideaux, au voilage léger des fenêtres. Oui, tout
est à sa place. L’oiseau jaune dans sa cage. La biscotte près d’un bol sur
la toile cirée. Une présence très bonne se déplace sur les patins de feutre.
Une autre cherche des biscuits dans le buffet. Ce sont mes grands-parents
d’adoption. Ceux que j’ai trouvés tard dans ma vie. Avec patience et opiniâtreté,
ils construisent chaque journée. Quand je suis chez eux c’est pour apprendre
que chaque chose vient en son temps. Ce sont des bâtisseurs.
Dans leur petite salle à manger tout chante. Les objets retrouvent leur
intelligence. Une cafetière saisie par leurs mains n’est plus la même. On
voit que l’anse en est fragile. On voit qu’elle est bleue. On voit qu’il
faut en maintenir le couvercle quand on sert, afin qu’il ne tombe pas. Le café
coule dans la tasse. On l’entend. Il fume. Des roses pâles plus loin, sur le
buffet, se fanent. On entend presque tomber les pétales. Rien depuis
l’enfance n’a égalé le charme doré de cette lumière qui pénètre
doucement à travers les stores qu’on a un peu baissés. J’aime ces gens. Je
me repose près d’eux. Parfois nous buvons du vin ensemble en riant. J’aime
la peau de leurs mains. J’aime comme ils touchent les objets. Avec infiniment
de soin, de délicatesse. Ce sont les gestes de la tendresse. D’abord ils
avancent les mains et du bout des doigts effleurent légèrement le contour des
choses, et les choses leur répondent comme elles répondent aux aveugles.
C’est émouvant, un objet qui présente une usure toujours au même endroit.
Des heures durant je resterais à contempler ceux qui travaillent de leurs
mains. Cet acharnement. Cette tendresse qui ne veut pas lâcher. Ces mains de
couturière, d’ébéniste, de raccomodeur de porcelaine, de cordonnier.
J’aime les outils. J’aime la main qui s’ouvre pour recevoir un outil.
(…)
Parfois, le dimanche, après le repas familial, mon père revêtait son
treillis. Il disait :
- bon, eh bien, je vais aller voir ce que deviennent mes plantations.. Qui veut
venir avec moi arracher les mauvaises herbes ?…
- Mon pauvre ami, disait ma mère en tirant une longue bouffée de sa cigarette.
Tes plantations.. Tes plantations… Tu en parles comme si nous avions un parc
!… Tu me fais bien rire avec tes deux pieds d’hortensias et tes trois pensées…
Je trouve que ça fait commun, les hortensias !
Mon père ne répondait rien. Il détournait le visage et se voûtait un peu.
Puis il descendait l’escalier lentement. Souvent je l’accompagnais, car
j’aimais farfouiller dans la terre avec lui. Il m’apprenait un tas de choses
sur les fleurs :
- Tu vois, Anne, j’ai planté les hortensias au pied du mur pour qu’ils
soient protégés du vent et qu’en même temps, ils aient de l’ombre. Ils
ont besoin de beaucoup d’eau. Tiens, va me remplir l’arrosoir, disait-il en
enfilant de vieilles bottines militaires me semblaient bien longues à lacer, et
qui se terminaient par une courroie qu’il fallait serrer dans une boucle sur
le haut de la cheville. Tout en travaillant dans le jardin, il fredonnait les
paroles d’une chanson, toujours la même :
- Le lendemain, elle était sourian-an-te, En arrosant ses petites fleurs
grimpan-an-tes,
Il avait l’air heureux.